Les banques françaises devront s’adapter à un nouveau cadre législatif très concret pour lutter contre la fraude aux chèques. La loi n° 2025-1058, promulguée le 6 novembre 2025, instaure de nouvelles obligations pour les établissements bancaires, visant à renforcer la sécurité des chèques et à faciliter la détection rapide des opérations frauduleuses. À l’heure où l’usage du chèque demeure vulnérable malgré sa décrue, ce texte marque un tournant dans la prévention des fraudes.
Un cadre législatif renforcé
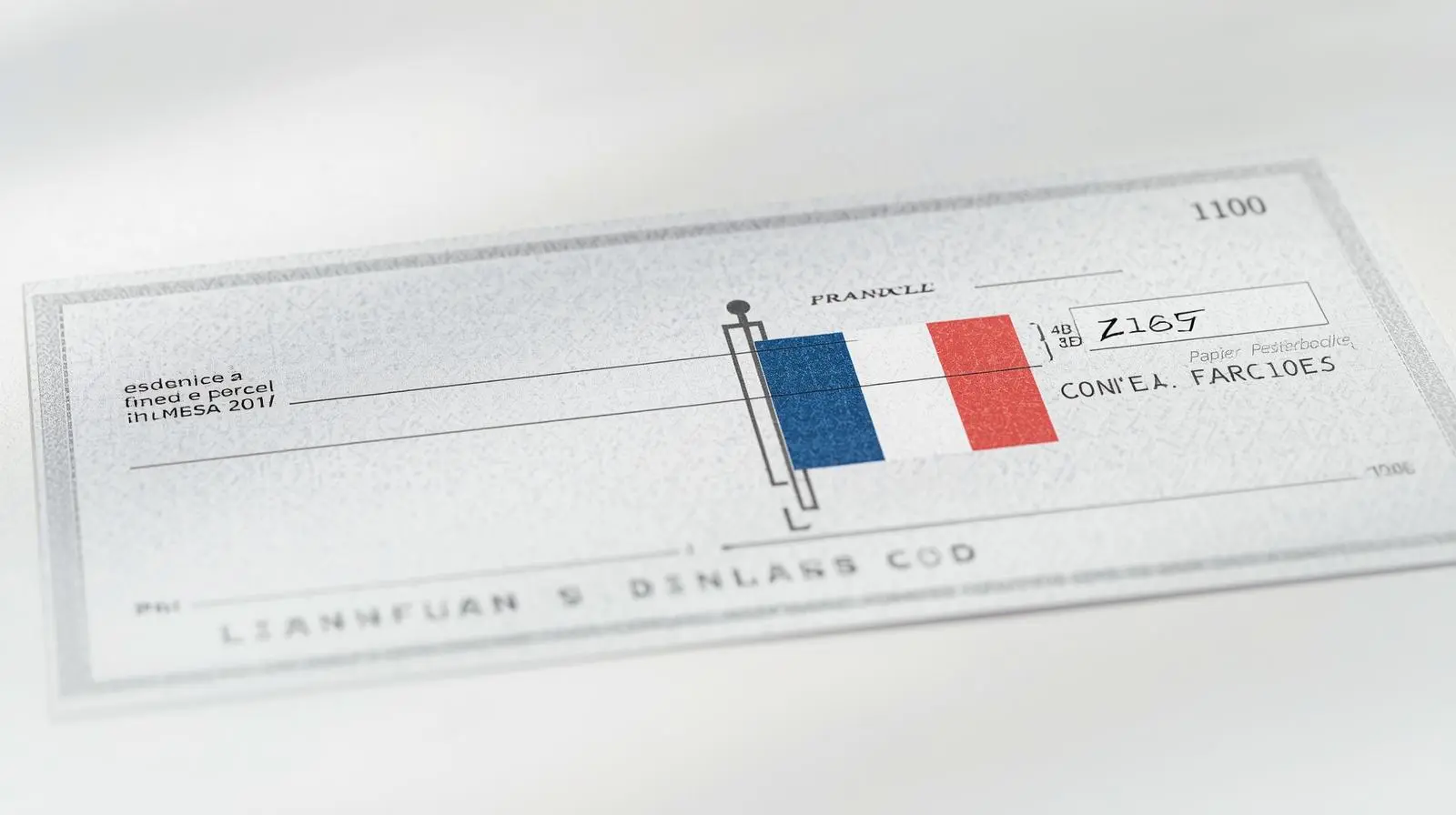
Adoptée à l’issue d’un long processus législatif, la nouvelle loi vise à moderniser les dispositifs existants de lutte contre les fraudes aux moyens de paiement, et à adapter ceux-ci aux spécificités du chèque. Elle est publiée au Journal officiel début novembre 2025.
Parmi les nouveautés :
- l’extension explicite du périmètre du Fichier national des chèques irréguliers (FNCI) aux chèques contrefaits ou falsifiés.
- l’obligation pour les banques d’envoyer sans délai à la Banque de France toute information relative à un chèque falsifié ou contrefait.
- la possibilité, pour les établissements, de consulter le FNCI dès la remise d’un chèque, avant même l’encaissement, afin d’anticiper un éventuel rejet ou une opposition.
Ces mesures s’inscrivent dans un contexte de vigilance accrue des autorités sur les moyens de paiement « traditionnels », dont le chèque reste l’un des plus exposés.
Pourquoi ce coup de frein maintenant ?
Le chèque conserve un taux de fraude supérieur à celui des autres moyens de paiement, ce qui en fait un vecteur de vulnérabilité. En 2024, il enregistrait encore un taux de fraude de l’ordre de 69 euros pour 100 000 euros de paiements. Le frein à son usage n’a pas suffi à en réduire totalement les risques.
La réservation à ce mode de paiement d’un usage plus marginal ne l’exonère pas d’être ciblé. La disparition progressive de son usage chez les particuliers ou les commerçants ne signifie pas que la fraude n’existe plus, bien au contraire : elle tend à être plus concentrée, plus ciblée, et plus dommageable.
Le gouvernement et les autorités bancaires ont estimé que « la fraude aux moyens de paiement constitue un enjeu crucial de justice économique et sociale ». Cette loi s’inscrit dans cette logique : renforcer les dispositifs afin de limiter les pertes, de protéger les consommateurs et de responsabiliser davantage les acteurs bancaires.
Ce qui change pour les banques
Signalement automatique et rapide
Désormais, lorsqu’une banque identifie un chèque contrefait (signature falsifiée, usage non autorisé) ou falsifié (mentions modifiées, bénéficiaire modifié, montant modifié) elle doit procéder sans délai à la transmission des données à la Banque de France. L’objectif : que le FNCI soit alimenté plus vite et soit plus réactif.
Vérification en amont à la remise
Jusqu’alors, la consultation du FNCI pouvait intervenir au moment de l’encaissement du chèque. Avec la nouvelle loi, la banque peut consulter immédiatement le fichier au dépôt du chèque, et différer l’inscription du crédit au compte du client si nécessaire. Cela permet d’éviter les avances sur encaissement de chèques irréguliers, qui pourraient ensuite se retourner contre le client.
Traçabilité renforcée
Chaque demande de vérification est désormais tracée. L’établissement doit documenter – et pouvoir justifier – pourquoi il a procédé ou non à une vérification du chèque auprès du FNCI. Cette exigence renforce la responsabilité des banques et leur devoir de vigilance.
Impacts sur les commerçants
Les acceptants de chèques (commerçants, artisans, particuliers) seront concernés : au dépôt du chèque remis par un client, la banque utilisera potentiellement le FNCI pour vérifier. En cas d’alerte, la remise de crédit pourra être différée. Les commerçants devront donc être conscients que les délais d’encaissement peuvent s’allonger.
Ce que cela signifie pour les clients
Pour les particuliers comme pour les professionnels, la nouvelle loi engendre une double conséquence : un renforcement de la sécurité mais aussi un ajustement des pratiques.
- Si vous remettez un chèque à votre banque, sachez que l’inscription du montant à votre compte peut être temporairement différée le temps d’une vérification.
- Si vous recevez un chèque de la part de quelqu’un, soyez vigilant : vol ou perte de chèque restent des modes de fraude très majoritaires.
- En cas de vol ou perte de chéquier, faites immédiatement opposition : cette action permet souvent d’éviter une fraude.
- Si vous êtes commerçant ou artisan, tenez compte que certains chèques pourront nécessiter une acceptation plus stricte : privilégier des modes de paiement plus sécurisés peut être une bonne précaution.
Enjeux et défis de mise en œuvre
Cohérence des fichiers et interconnexion
Le FNCI existe depuis plusieurs années. Mais l’extension de son périmètre aux falsifications et contrefaçons, et la consultation en amont exigent que les banques adaptent leurs systèmes d’information et leurs process internes. La coordination avec la Banque de France est essentielle.
Équilibre entre fluidité et sécurité
Il s’agit pour les banques de concilier la rapidité des paiements (un remboursement ou une inscription rapide au compte est un service attendu) avec le contrôle renforcé. Le risque : que des clients subissent des retards sans raison, ou que les banques soient trop prudentes et « bloquent » des opérations légitimes.
Sensibilisation des usagers
Pour que la loi porte ses fruits, les particuliers et les entreprises doivent être informés : comprendre pourquoi un chèque peut être vérifié, pourquoi il peut y avoir un délai. Une meilleure culture de vigilance reste indispensable.
Maintien de l’usage du chèque
Le chèque est un usage « en voie de disparition », mais encore présent. Le défi est de sécuriser ce mode de paiement sans le rendre inutilisable ou sans imposer à tous une transition pure vers le paiement numérique. Certains professionnels en ont encore besoin dans des contextes spécifiques.
Focus sur les typologies de fraude au chèque
Les principaux schémas de fraude sur les chèques étaient déjà identifiés :
- Cheques volés ou perdus : le fraudeur encaisse directement le chèque sur son compte ou le fait rembourser.
- Falsifications : modification du montant, du bénéficiaire ou rachat d’un chèque dans le circuit.
- Contrefaçons : usage d’un chèque dont l’émission est frauduleuse (signature non authentique).
Selon les statistiques les plus récentes, la presque totalité des fraudes au chèque provient de vols ou pertes, autour de 89%. Le taux de fraude sur le chèque reste le plus élevé parmi les moyens de paiement.
La nouvelle loi traite explicitement contrefaçons et falsifications, ce qui était jusqu’alors couvert de façon moins visible dans le dispositif.
Un paysage bancaire déjà en transformation
Le contexte global de la fraude aux moyens de paiement montre des évolutions significatives : la fraude par carte, par virement ou par prélèvement est surveillée de près, mais le chèque conserve un profil à risque plus soutenu. En 2024, la fraude au chèque représentait encore plusieurs centaines de millions d’euros malgré une diminution relative.
La publication de la nouvelle loi intervient dans ce contexte, pour capter les fragilités restantes du système. Les banques, les organismes de paiement, la Banque de France et les consommateurs se trouvent donc engagés dans une phase de transition : adaptation des systèmes, nouvelles procédures de dépôt, information des usagers.
Exemples concrets : ce qui va évoluer en pratique
- Vous déposez un chèque dans votre application bancaire ou au guichet : la banque peut lancer une vérification automatique au FNCI. Si une alerte est détectée, elle peut décider de ne pas créditer immédiatement le montant.
- En tant que commerçant, vous encaissez un chèque d’un client : votre banque peut remonter l’information à la Banque de France si ce chèque s’avère falsifié. Vous devez donc vous assurer que l’émission du chèque est faite de manière régulière.
- En cas de vol ou perte de votre chéquier : vous devez faire opposition rapidement. Non seulement pour bloquer toute émission future, mais aussi pour éviter que des chèques ne soient remis au dépôt et provoquent des pertes. L’enregistrement au FNCI sera alimenté plus vite grâce à la nouvelle loi.
- Du côté bancaire, un établissement doit revoir ses processus internes : dans ses guichets, dans ses applications de dépôt de chèques, dans ses systèmes de gestion des alertes FNCI. Des temps de crédit différé ou des « blocages temporaires » pourront devenir plus fréquents, mais toujours dans un objectif de sécurité.
Impact attendu et perspectives
Pour les victimes de fraude
Le délai de détection sera réduit, ce qui devrait limiter les pertes individuelles. Une fois l’alerte remontée, le FNCI pourra mieux prévenir d’autres établissements d’un même bénéficiaire ou d’un même émetteur suspect.
Pour les banques
L’adaptation au nouveau cadre représente un investissement : systèmes, formation, process. En revanche, cela permet de réduire les risques de fraudes coûteuses à récupérer, d’anticiper les blocages et d’améliorer la confiance client.
Pour l’économie
Une meilleure lutte contre la fraude aux chèques peut renforcer la confiance dans les moyens de paiement traditionnels. Cela évite une rupture brutale d’usage pour certains segments (commerçants, petites structures). Cela contribue aussi à l’équité économique : la fraude bancaire pèse sur tous les clients, via des coûts indirects.
Pour les 10-20 prochaines années
Si les chèques continuent de se raréfier, ce texte pose un socle de sécurité qui pourra être utilisé pour d’autres moyens de paiement papier ou hybride. Il marque aussi un signal fort : la fraude ne tolère plus de zones grises. D’autres dispositifs pourraient suivre pour d’autres modes de paiement en voie de disparition ou de transition.
À retenir
La loi du 6 novembre 2025 marque une étape majeure dans la lutte contre la fraude aux chèques. Elle impose aux banques une obligation de vigilance renforcée : signalement plus rapide, vérification plus tôt, traçabilité accrue. Les clients et commerçants devront s’adapter : des délais d’encaissement peuvent se rallonger, des contrôles peuvent intervenir, mais le gain attendu est une sécurité accrue. Dans un contexte où la fraude aux moyens de paiement reste active, cette réforme vise à réduire une vulnérabilité persistante et à responsabiliser l’ensemble de la chaîne bancaire. Les prochaines semaines seront cruciales pour voir comment ces mesures seront réellement mises en œuvre et ressenties par les usagers.



