Une réforme salariale sans effets visibles sur l’absentéisme
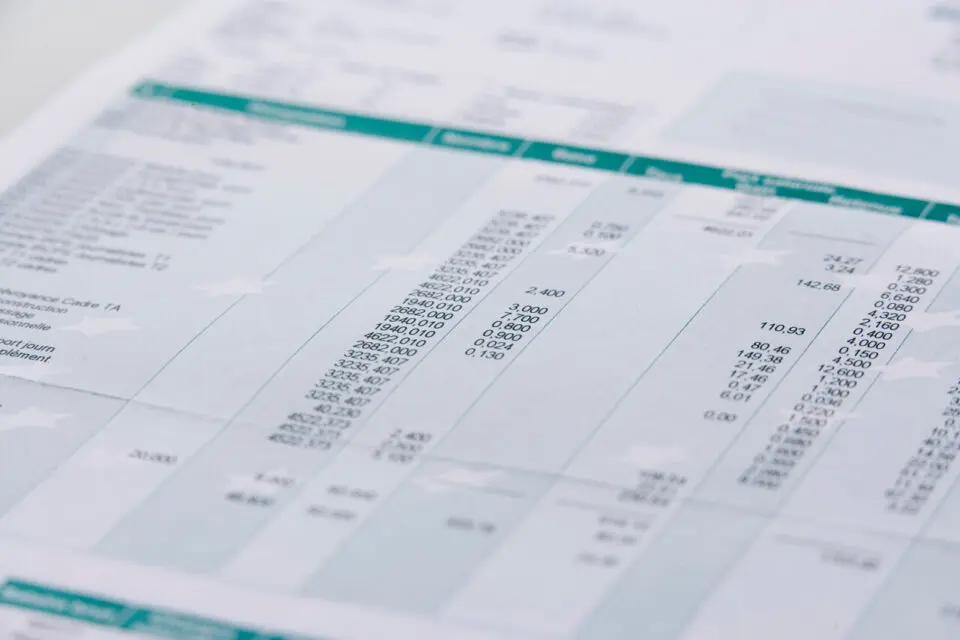
Depuis mars 2025, les agents territoriaux dont l’état de santé nécessite un congé de maladie ordinaire ne perçoivent plus que 90 % de leur traitement pendant les trois premiers mois d’arrêt. Cette mesure, voulue par l’exécutif pour responsabiliser les agents et réduire l’absentéisme dans la fonction publique territoriale, devait générer un effet dissuasif clair. Mais huit mois après son entrée en vigueur, les premiers résultats montrent un tout autre visage.
Une étude publiée le 13 novembre par l’Observatoire Adelyce, qui analyse la masse salariale de la fonction publique territoriale, révèle que cette mesure n’a pas entraîné de baisse significative des arrêts maladie. Au contraire, des signaux inattendus apparaissent, notamment une hausse des accidents du travail et des accidents de trajet.
L’objectif affiché par le gouvernement, qui consistait à faire baisser le nombre de jours d’arrêt tout en allégeant la charge financière des collectivités, semble donc loin d’être atteint.
Une réforme appliquée dans un contexte social déjà tendu
Le choix de réduire le traitement des agents en congé maladie avait suscité de fortes réactions lors de son annonce. Les syndicats dénonçaient une mesure injuste, accusant l’État de punir la maladie plutôt que de traiter les causes profondes de l’absentéisme.
L’exécutif, lui, assurait vouloir lutter contre les arrêts jugés abusifs, estimant que le maintien intégral du salaire constituait un facteur de surconsommation des congés maladie. C’est dans ce contexte que la réduction à 90 % du traitement a été instaurée, avec la promesse d’économies substantielles pour les collectivités territoriales.
Huit mois plus tard, la réalité décrite par l’étude Adelyce contredit largement cette prédiction.
Une économie budgétaire dérisoire
L’étude se fonde sur les déclarations sociales nominatives de 170 collectivités. Elle montre que la réduction du traitement des agents malades n’a permis qu’une économie de 0,17 % de la masse salariale.
Un chiffre qualifié de « pas très élevé » par Jérémy Lalanne, chef de produit à Adelyce. Cette économie marginale ne correspond en rien aux attentes initiales du gouvernement, qui envisageait une baisse significative des dépenses liées aux arrêts maladie.
Cette faible économie s’explique par deux facteurs liés : le nombre d’arrêts n’a pas diminué et la durée moyenne des arrêts n’a pas été affectée de manière notable. Autrement dit, les agents continuent de tomber malades comme avant la réforme, et lorsqu’ils s’arrêtent, ils s’arrêtent tout autant qu’avant.
Aucun impact statistiquement significatif sur les arrêts maladie
L’observation principale de l’étude est claire : malgré la baisse du traitement, les arrêts maladie ne diminuent pas. Les agents territoriaux n’ont pas modifié leurs comportements. Les personnes souffrant d’un problème de santé continuent de solliciter un arrêt.
Les responsables de l’étude expliquent que l’arrêt maladie reste un acte encadré par un médecin, qui applique des critères médicaux indépendants de l’évolution de la rémunération. L’agent ne peut pas décider seul de raccourcir son arrêt, ni de le prolonger sans justification médicale.
Ce constat bat en brèche l’idée selon laquelle la réduction du salaire pourrait inciter les agents à reprendre plus vite ou à s’arrêter moins souvent.
Une inquiétante hausse des accidents du travail et des accidents de trajet
L’étude souligne un phénomène préoccupant : depuis la mise en œuvre de la réduction salariale, on observe une augmentation des accidents de travail et de trajet.
Les analystes n’en tirent pas de conclusion définitive, mais la corrélation interroge. Plusieurs interprétations sont possibles. Certains agents pourraient hésiter à demander un arrêt maladie par crainte de la perte salariale et se rendre au travail malgré des symptômes, augmentant leur risque d’accident.
D’autres pourraient se présenter au poste alors qu’ils ne sont pas en état d’assurer leurs missions, ce qui favorise les erreurs, les chutes ou les incidents. Dans ce cas, la réforme viserait l’objectif inverse de celui annoncé, en fragilisant la sécurité au travail.
Adelyce appelle donc à une vigilance accrue et à l’examen approfondi de cette tendance inquiétante.
La question du présentéisme : un effet pervers déjà bien documenté
Le présentéisme, c’est-à-dire le fait de travailler malgré un état de santé dégradé, est un phénomène déjà bien connu dans la fonction publique comme dans le secteur privé. Lorsque les conditions financières d’un arrêt maladie sont dégradées, certains salariés choisissent de se rendre au travail coûte que coûte, même lorsqu’ils devraient rester chez eux.
Ce réflexe est souvent contre-productif. Il aggrave les pathologies, retarde la guérison ou provoque des complications. Il augmente aussi les risques d’erreurs ou d’accidents professionnels.
Dans une collectivité territoriale, les métiers physiques sont nombreux : agents techniques, personnels de voirie, agents d’entretien, conducteurs de véhicules spécialisés. Se présenter malade dans ces fonctions peut devenir dangereux.
L’étude Adelyce suggère fortement que la réduction du salaire pendant un arrêt pourrait favoriser ce présentéisme, expliquant en partie la hausse observée des accidents.
Les collectivités face à une mesure qu’elles n’ont pas choisie
Si l’État a imposé cette réforme, ce sont les collectivités territoriales qui en subissent directement les conséquences. Elles doivent gérer la masse salariale, les absences, les remplacements, l’organisation du service public, et désormais les effets inattendus de la baisse de rémunération.
Pour de nombreuses communes, départements ou intercommunalités, les économies réalisées sont si faibles qu’elles ne justifient pas les complications administratives générées par la réforme.
Certaines collectivités craignent même une détérioration du climat social. Les agents, déjà soumis à des charges de travail croissantes et à une pression accrue sur les effectifs, perçoivent cette mesure comme une sanction injuste.
La question du moral des équipes se pose avec insistance.
Les syndicats dénoncent une réforme inefficace et injuste
Les organisations syndicales avaient anticipé ce scénario. Elles dénoncent depuis le premier jour une réforme punitive, qui pénalise les agents sans traiter les causes réelles de l’absentéisme.
Selon elles, les arrêts maladie augmentent souvent en réponse à des conditions de travail difficiles : surcharge, stress, risques psychosociaux, exposition aux intempéries, tensions internes, manque de reconnaissance.
Réduire le traitement ne change rien à ces réalités. Les syndicats estiment même que la politique actuelle aggrave la situation en dégradant la confiance et en diminuant l’attractivité de la fonction publique territoriale.
Cette étude vient renforcer leur argumentaire : la mesure ne produit aucun bénéfice concret, mais génère des risques supplémentaires.
Les employeurs territoriaux espéraient un soutien financier plus important
Les collectivités espéraient que la réforme dégagerait des marges budgétaires utiles dans un contexte où elles sont confrontées à une hausse continue des coûts. Le prix de l’énergie, les dépenses sociales, l’entretien des infrastructures et le coût des matériaux pèsent lourd sur leurs budgets.
L’économie moyenne de 0,17 % est jugée trop faible pour compenser ces pressions. Certaines collectivités constatent même une hausse de leurs dépenses liées aux accidents du travail, qui neutralise partiellement les économies attendues.
Elles se retrouvent donc dans une position inconfortable : appliquer une réforme impopulaire, surveiller ses effets indésirables et constater que les gains financiers sont loin des projections initiales.
Un débat national qui risque de se poursuivre
Les résultats publiés par l’Observatoire Adelyce risquent de relancer un débat national sur la pertinence de la réduction salariale en cas de maladie. Plusieurs experts estiment qu’une telle mesure ne peut fonctionner qu’à condition d’être accompagnée d’un plan global de prévention des risques professionnels.
Le gouvernement avait annoncé vouloir surveiller les effets de la réforme avant d’envisager des ajustements. Cette étude constitue donc un premier jalon dans l’évaluation officielle.
Reste à savoir si l’exécutif acceptera de revoir sa stratégie ou s’il choisira au contraire de maintenir le cap en espérant un effet plus visible dans les années à venir.
Des pistes pour améliorer la lutte contre l’absentéisme
Les collectivités qui cherchent à réduire l’absentéisme explorent déjà d’autres pistes. Certaines renforcent les politiques de prévention, améliorent les équipements, réorganisent les services ou développent des dispositifs de soutien psychologique.
Les experts en ressources humaines insistent sur une idée simple : l’absentéisme se combat mieux en améliorant les conditions de travail qu’en sanctionnant financièrement la maladie.
Une meilleure formation managériale, une attention portée au climat social, des horaires adaptés et une politique active de prévention peuvent réduire durablement les arrêts.
L’étude Adelyce semble valider cette approche en montrant qu’une logique strictement financière produit peu d’effets, voire des conséquences contraires à celles recherchées.
En conclusion : une mesure coûteuse socialement, mais peu rentable financièrement
L’étude publiée le 13 novembre apporte un éclairage inédit sur les premiers effets d’une réforme controversée. La baisse du salaire des agents en arrêt maladie n’a pas permis de réduire l’absentéisme, n’a généré qu’une économie marginale, et semble même s’accompagner d’effets secondaires préoccupants, notamment la hausse des accidents du travail.
Le débat reste ouvert, mais un constat s’impose déjà : la réduction du traitement n’est pas un levier efficace pour améliorer la santé des agents ni pour stabiliser les finances locales.
Les prochains mois diront si l’exécutif persiste dans cette voie ou s’il choisit d’aborder différemment la question de l’absentéisme, en ciblant davantage les causes structurelles et organisationnelles.
Une chose est sûre : les collectivités attendent des réponses claires et des solutions réellement adaptées aux réalités du terrain.


